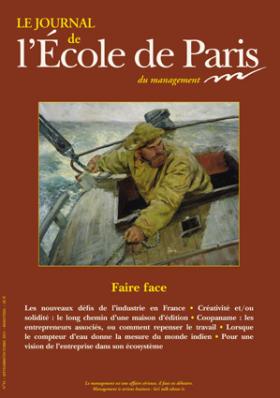
Faire face
septembre/octobre 2011
L'édito de Michel BERRY
La période des Trente Glorieuses paraît aujourd’hui comme un paradis: tout se vendait et il fallait optimiser l’emploi de ressources rares qu’étaient les machines, les capitaux et la main-d’œuvre. Le monde était porté par la croissance, et l’on savait prévoir, du moins les erreurs de prévision étaient vite épongées. C’est dans ce contexte qu’ont émergé les sciences de gestion, qui proposaient d’appliquer à la vie des affaires des méthodes qui avaient réussi en physique et en mécanique: le management allait devenir une affaire bien réglée.
Cette époque paraît bien lointaine aujourd’hui. Après le paradis de la pénurie, nous sommes entrés dans l’enfer de l’abondance: on a trop d’usines, de produits, de main-d’œuvre, dans les pays développés du moins. L’obsession est de vendre, de résister à la concurrence, d’innover, d’être assez résilient pour survivre face à un environnement hostile. Voyons cela avec les articles de ce numéro.
On aime l’industrie comme pourvoyeuse d’emplois et l’on s’insurge devant les fermetures d’usines ou les délocalisations, mais le premier article montre qu’il reste un long chemin à faire à l’opinion, aux politiques et aux institutions pour traiter les entreprises comme des ressources précieuses mais fragiles. En attendant, il faut compter sur les courageux qui font face à un environnement défavorable par rapport à leurs concurrents. Il en existe, heureusement, on en voit d’ailleurs régulièrement à l’École de Paris.
La concentration de l’édition pousse à l’industrialisation: des best-sellers formatés, voilà qui plaît aux grands éditeurs. Les auteurs sortant des normes peuvent se tourner vers de petits éditeurs, mais ceux-ci sont trop fragiles pour exploiter les succès. Les Éditions de l’Olivier sont à la fois petites par la taille et grandes par l’influence. Cela tient à plusieurs facteurs: la passion d’un éditeur, lecteur boulimique; son exigence, il ne veut publier que des livres qu’il a lus; sa modestie, il se contente de 35 parutions par an; et aussi à un intelligent partenariat avec Le Seuil. Voilà qui permet de tenir dans un monde qui perd ses marques.
Raymond Barre l’avait dit: «Si vous n’avez pas d’emploi, créez-le!» La formule a fait son chemin, au point que nombre de chômeurs sont incités à créer leur activité comme auto-entrepreneurs. Cette formule séduisante masque des risques considérables, et c’est ce qui a incité à la création de coopératives d’activités et d’emploi, dont Coopaname est un exemple emblématique. Elles permettent de concilier les risques de l’entrepreneur et la sécurité d’un contrat de salarié, et aussi rompre l’isolement qui pèse si souvent aux entrepreneurs.
Les habitants de Chennaï sont habitués à faire face à la pénurie d’eau avec des palliatifs divers, dont de petits arrangements où agriculteurs et politiques trouvent leur intérêt. Arrive une entreprise occidentale pour moderniser le réseau et répartir l’eau en la mesurant grâce aux compteurs d’eau auxquels nous ne prêtons plus attention tant ils font partie de notre paysage. Cela va-t-il être considéré comme un bien? Pas vraiment, non seulement parce qu’il faut payer l’eau plus cher, mais aussi parce que le compteur met à mal les réseaux de solidarité qui aidaient à survivre.
Penser en termes de réseaux est la nouvelle étape du double projet de Danone. Muriel Pénicaud l’explique, une entreprise ne peut prospérer durablement si son environnement se délite. Or, une puissante multinationale peut mettre à mal, sans bien s’en rendre compte, sous-traitants et territoires. D’où l’idée de se penser comme un élément d’un écosystème et de se donner des moyens d’investigation et d’intervention hors des frontières de l’entreprise. C’est le but du fonds Danone Écosystème et du lancement d’initiatives originales, en commençant par des partenaires parmi les plus vulnérables.
Les économistes aiment à représenter la vie des affaires comme résultant de l’interaction d’acteurs poursuivant leur intérêt individuel, mais les systèmes qui résistent sont faits de réseaux patiemment entrelacés, et souvent difficiles à défaire.
Lire la suite
Coopaname : les entrepreneurs associés, ou comment repenser le travail
28 avril 2011 | Séminaire Economy and meaning
Lorsque le compteur d'eau donne la mesure du monde indien
21 mars 2011 | Séminaire Company cultures and managements

