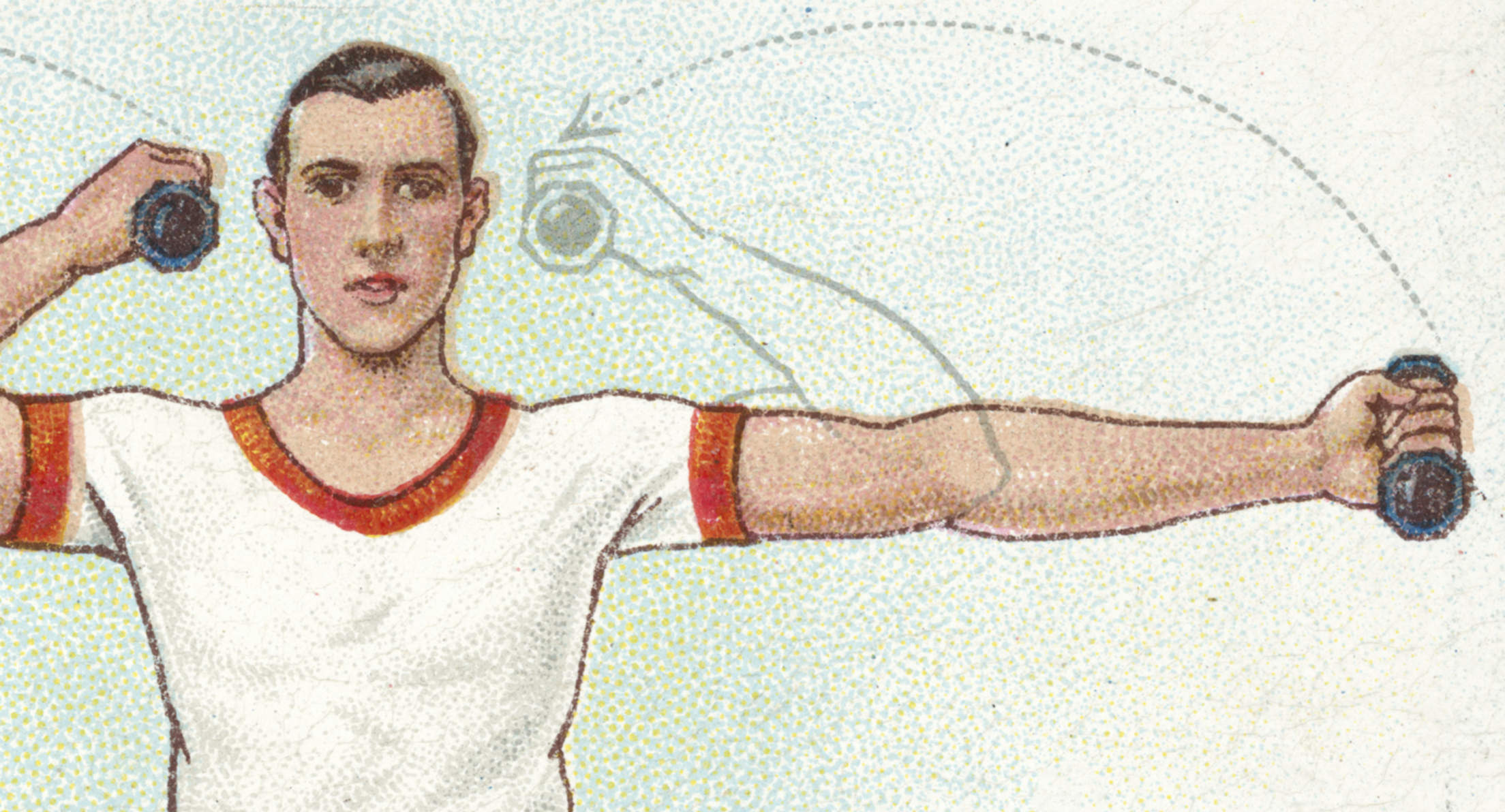La meilleure et la pire des choses
Je me souviens d’être entrée par hasard, il y a quelques années, dans une exposition “d’innovations pour une planète durable” organisée dans le centre de Paris. J’y avais découvert, interloquée, des espèces de tanks rutilants présentés comme des voitures écologiques, car électriques. Juste à côté figuraient des lits en carton ondulés et des tabourets multicolores fabriqués à partir de plastique recyclé.
Dans mon esprit, un véhicule électrique, pour être écologique, devait, avant tout, être un petit véhicule, à la fois pour économiser de la matière première et parce que, comme dans l’aviation, tout poids additionnel entraîne une consommation d’énergie supplémentaire et que le kilowattheure le plus écologique est celui que l’on ne consomme pas. Je m’étais donc convaincue que toute grosse voiture électrique était un scandale.
Cette idée était voisine d’une autre, qui ne reposait pas du tout sur les mêmes fondements : je croyais que le concept de camion électrique était une ineptie, parce que les camions parcourent des milliers de kilomètres, qu’ils ont donc besoin d’une très grande autonomie et que les batteries nécessaires à leur alimentation occuperaient une partie trop importante de leur volume, au détriment de l’espace utile. Christophe Midler, lors d’une intervention à l’École de Paris en 2021, notait d’ailleurs que, pour les poids lourds, la batterie électrique « ne présentait pas grand intérêt ». Pour les autobus, au contraire, le recours à l’électricité me paraissait pertinent, compte tenu du faible nombre de kilomètres parcouru et de la possibilité de les recharger régulièrement.
Dans le premier article de ce Journal, Patrick Pélata vient ébranler mon opinion sur les poids lourds électriques en évoquant un camion Mercedes équipé d’une batterie qui se recharge de 20 à 80 % en trente minutes et qui lui donne une autonomie de 500 kilomètres, ces performances s’avérant « particulièrement adaptées aux temps de conduite des chauffeurs et à la réglementation à laquelle ils sont soumis (arrêts obligatoires de quarante-cinq minutes au bout de quatre heures trente de conduite, soit moins de 400 km). » Si la question de l’autonomie et de la taille des batteries des camions est résolue par la règlementation sur le temps de conduite des chauffeurs, construire des camions électriques cesse d’être une ineptie.
Dans le concept de “grosse voiture électrique”, l’absurdité ne vient pas de la taille du véhicule (les autobus sont, d’ailleurs, beaucoup plus volumineux que les voitures), mais de celle des batteries indispensables à la très grande autonomie exigée par des conducteurs qui, contrairement aux routiers, ne sont pas astreints à s’arrêter toutes les quatre heures trente. Elle vient aussi et surtout de la masse de matériaux nécessaires pour construire ces voitures (jusqu’à 2 ou 3 tonnes), de l’énergie mobilisée pour déplacer cette masse, et enfin, du contraste insensé entre d’une part, cette masse et cette énergie et, d’autre part, la charge utile transportée, à savoir, statistiquement, moins de deux personnes de 60 à 80 kilos.
Cela dit, l’ineptie ultime est révélée par Patrick Pélata à la fin du débat : « Le bonus écologique s’applique aujourd’hui à des voitures électriques valant jusqu’à 47 000 euros. » Quand j’ai visité l’exposition consacrée aux innovations pour une planète durable, j’ai été choquée de voir ces monstres métalliques qualifiés d’écologiques, mais j’ignorais que, de surcroît, cette qualification se traduisait par un bonus lui aussi “écologique” et versé en espèces sonnantes et trébuchantes, pouvant atteindre 4 000 euros. Vérification faite, ce bonus s’applique à des véhicules d’un poids maximal de 2,4 tonnes, ce qui signifie que les pouvoirs publics encouragent, par des subventions, les consommateurs ayant besoin de 2,4 tonnes pour déplacer leurs 60 kilos. Or, comme le souligne Patrick Pélata, « ce seuil pourrait être progressivement abaissé à 30 000 euros, de manière à inciter les constructeurs à produire des voitures électriques abordables et populaires ». Comme la langue d’Ésope, la règlementation peut vraiment être la meilleure et la pire des choses...