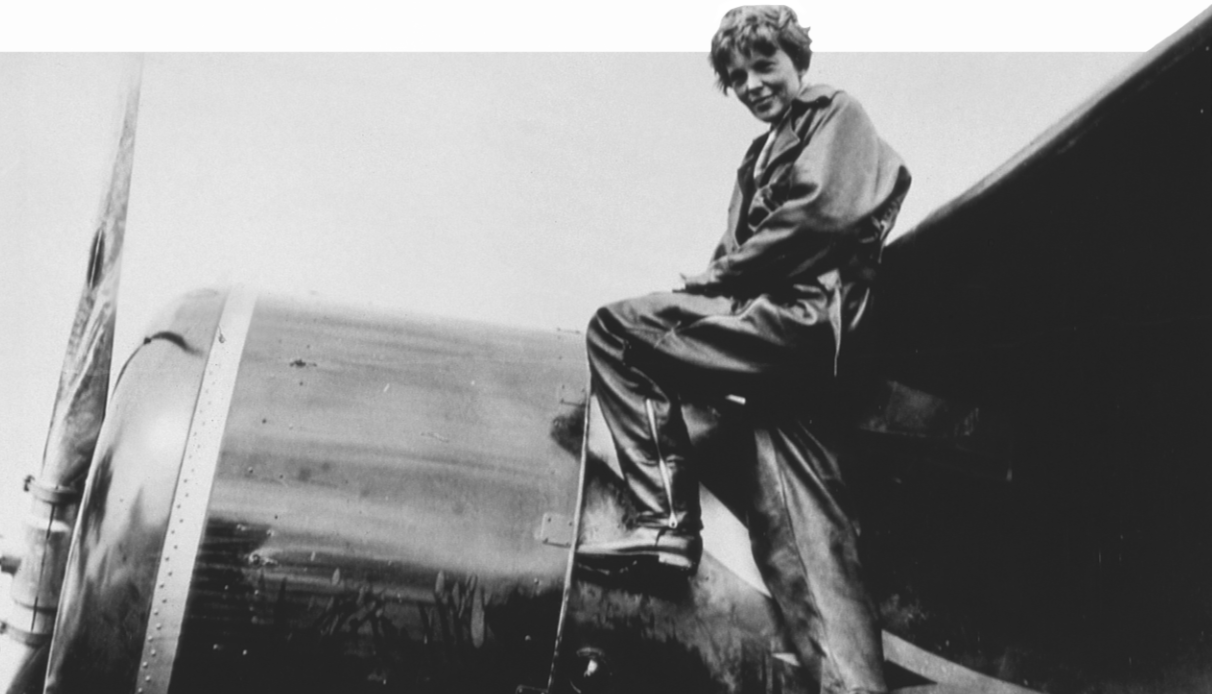- Contexte des activités lucratives monastiques
- Les monastères et l’innovation
- Perspectives
- Qualité et critères de fabrication des produits monastiques
- Équilibre financier des communautés monastiques
- Les partenariats avec de nouveaux acteurs laïcs et leur impact perturbateur
- Sobriété et production : comment les concilier ?
Comment les monastères, organisations séculaires, arrivent-ils à tenir le fragile équilibre entre leurs priorités spirituelles, leur vie de sobriété en retrait du monde, les nécessités de trouver des revenus pour (sur)vivre et les exigences toujours plus pressantes et normées des marchés ? Marie-Catherine Paquier nous montre comment ces écosystèmes se sont approprié les outils de gestion pour développer un art du management de la sobriété. Elle détaille en particulier une pratique nuancée du marketing fondée sur « ce qui suffit ».
Exposé de Marie-Catherine Paquier
J’ai exercé pendant plus d’une dizaine d’années des fonctions commerciales et marketing en entreprise avant de devenir enseignante en école de commerce. Je me suis ensuite tournée vers la recherche et j’ai soutenu ma thèse au Cnam. Mes premiers travaux de recherche, entamés il y a une douzaine d’années, ont porté sur l’économie monastique. Ce thème m’intéressait à titre personnel, mais aussi parce qu’il croise sur le plan académique deux logiques en apparence incompatibles : la logique du monde monastique, qui vit en retrait du monde, en clôture, en silence, sur un temps long, et la logique du monde de la consommation, qui s’insère dans un monde profane, fait d’interconnexions, de bruit et d’immédiateté.
Les produits monastiques sont l’un des points de rencontre entre ces deux logiques. Issus et fabriqués par des institutions séculaires, ces produits sont totalement dans l’air du temps. Naturels, artisanaux, locaux, ils sont porteurs d’une dimension éthique.
J’ai acquis très progressivement une légitimité dans le monde monastique, alors que j’ai débuté sans accointances particulières avec cet univers. Mes premiers travaux de recherche, qui s’appuyaient sur des observations externes, ont été jugés utiles et ont été mis en œuvre dans certaines communautés monastiques, ensuite de quoi j’ai petit à petit été acceptée sur le terrain.
Je vous présente aujourd’hui une synthèse de ces travaux. Dans la lignée de la dernière séance de ce séminaire, dont l’orateur était Franck Aggeri1, mon exposé poursuit trois questionnements : la finalité de l’innovation monastique, la capacité de discernement et la quête d’un marketing alternatif visant la sobriété dans la consommation.
Contexte des activités lucratives monastiques
L’offre lucrative des monastères contemplatifs
L’offre de produits des 290 monastères contemplatifs chrétiens français est composite. Parmi les 4 000 références de produits, on trouve des produits alimentaires (biscuits, confitures, huiles, vin, bière, jus de fruits, etc.) et des produits non-alimentaires (cosmétiques, objets de décoration, de piété, produits de couture, etc.). Les monastères offrent aussi des services comme l’impression ou la restauration de tableaux.
Vous ne pouvez pas lire la suite de cet article