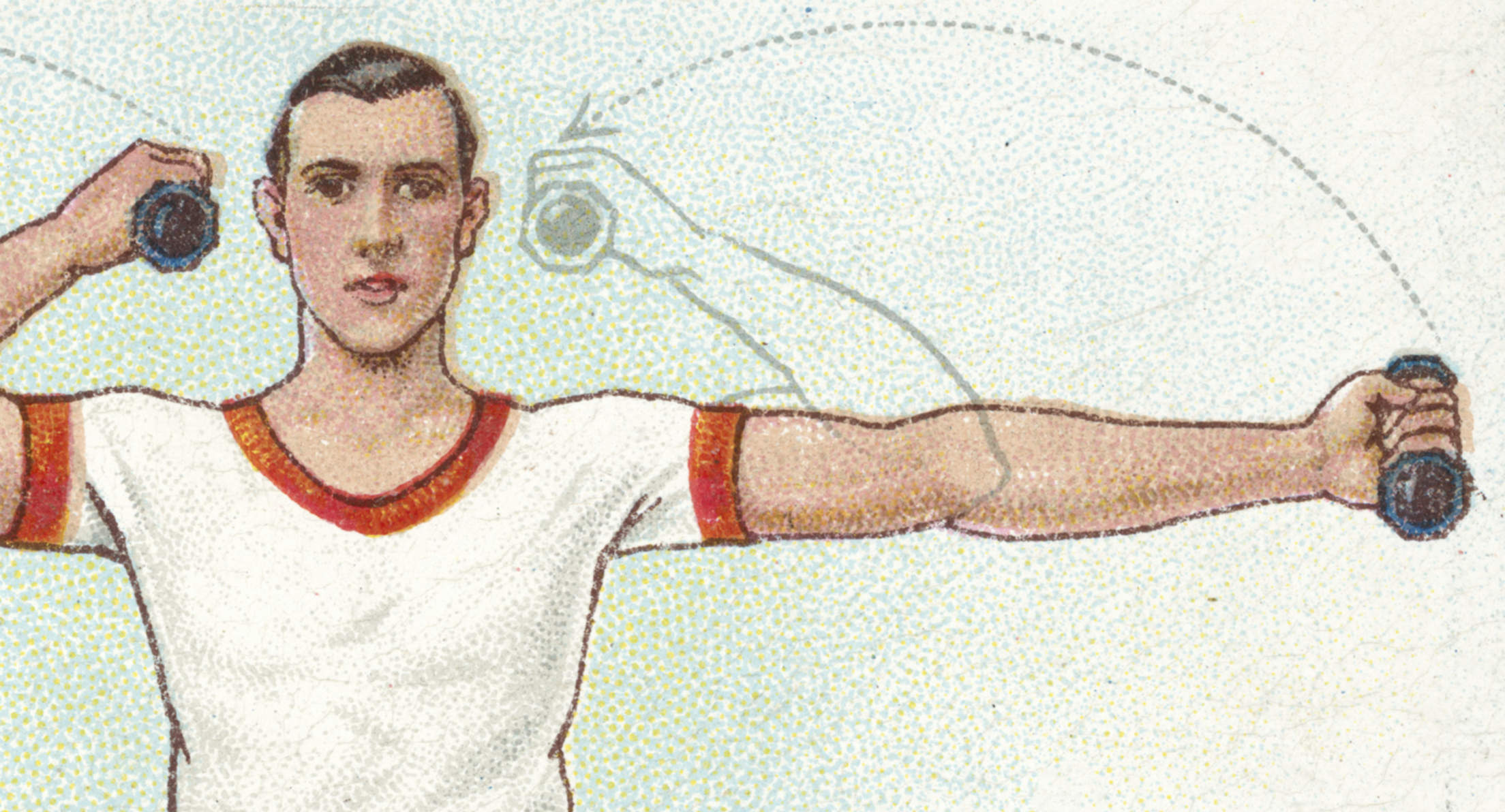Concilier décarbonation et compétitivité : un défi pour l’Europe
En novembre 2024, l’annonce de la suspension du projet de décarbonation d’ArcelorMittal en France a achevé une année difficile pour la décarbonation des industries française et européenne, face au ralentissement macroéconomique et, s’agissant de l’industrie sidérurgique, au dumping chinois. De quoi rappeler que la compétitivité reste, à ce jour, un préalable à la décarbonation. Comment l’Europe aide-t-elle son industrie à concilier ces deux objectifs ?
L’ambition climatique à l’épreuve du terrain
C’était il y a dix ans : l’Union européenne se fixait pour objectif, dans la foulée de l’Accord de Paris, de devenir le premier continent neutre en carbone en 2050. Depuis, Bruxelles a fixé, puis réhaussé ses objectifs intermédiaires pour 2030 et s’est dotée de plusieurs textes réglementaires pour tenir ses propres échéances : suivi chiffré du développement des énergies renouvelables, réduction du volume de quotas carbone en circulation, interdiction des véhicules à moteur thermique en 2035, etc. En aval, entreprises et ménages doivent de concert accélérer leurs efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En France, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, le secteur industriel est, par exemple, enjoint à aller deux fois plus vite par rapport à sa trajectoire historique, au prix d’investissements de plusieurs milliards d’euros par an dans la sortie des énergies fossiles et dans la modification des procédés de production.
Or, cette ambition environnementale s’observe, rappelons-le, dans un contexte d’économie ouverte caractérisé tout à la fois par une asymétrie des politiques climatiques, par un différentiel du prix des énergies à la défaveur de l’Europe, et par une concurrence étrangère féroce; en témoignent les difficultés que rencontre l’industrie automobile européenne face aux constructeurs chinois de véhicules électriques. En matière de décarbonation, ces déséquilibres multiples laissent craindre des arbitrages industriels dommageables dans le temps et dans l’espace : privilégier la prudence, voire l’attentisme avant d’engager de lourds investissements verts – à l’instar du groupe ArcelorMittal en France –, consentir ces mêmes investissements ailleurs dans le monde ou, pis, délocaliser la production. Un tel scénario de “fuites de carbone” fragiliserait de fait la politique climatique européenne, qui n’a pas vocation à se faire au profit d’une désindustrialisation ni d’une augmentation des émissions importées.
Le prix du carbone en toile de fond
Dans cet environnement mondial, l’Union européenne n’a pas d’autre choix, à ambition climatique inchangée, que de créer les conditions d’une décarbonation compétitive; en d’autres termes, de faire de la décarbonation un investissement souhaitable et rentable, ici et maintenant.
Au vu des avancées structurelles contenues dans le paquet législatif Fit for 55, l’Europe, fidèle à sa tradition ordolibérale, a fait le choix de privilégier les mécanismes de marché, en faisant du prix de la tonne de carbone le juge de paix de la décarbonation compétitive. D’une part, la réforme du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), consistant à réduire le volume de quotas en circulation, a vocation à faire augmenter le prix du quota par le jeu de l’offre et de la demande; de quoi fournir l’incitation économique à la décarbonation pour laquelle ce système avait été initialement conçu. D’autre part, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), attendu dans sa phase opérationnelle en 2026, cherche à loger certaines productions extra-européennes à la même enseigne (importations d’acier, d’aluminium, de ciment, d’engrais, d’hydrogène et d’électricité), en les exposant elles aussi au prix européen du carbone lorsqu’elles arrivent sur le marché européen. On le voit, en internalisant le prix du carbone dans la structure des coûts, l’Europe cherche à donner un avantage compétitif aux producteurs les plus vertueux. Charge aux industriels européens, dans ce terrain de jeu équitable, de se décarboner plus rapidement que leurs concurrents pour en bénéficier.
En amont, soutenir la décarbonation
Néanmoins, même dans un contexte économique et géopolitique plus favorable, décréter la décarbonation de l’industrie européenne ne suffirait pas pour qu’elle advienne. Lourdeur des investissements, prix élevés de l’électricité, immaturité des technologies (hydrogène décarboné, capture et transport de CO2...) sont autant d’obstacles structurels à lever en amont sur le plan technico-économique.
En matière d’actions publiques, ces contraintes industrielles invitent l’Europe à décliner sa politique climatique au-delà des seuls mécanismes incitatifs et punitifs qui n’en constituent finalement qu’un premier maillon. Dans cette perspective, une approche davantage holistique semble déjà à l’œuvre, du moins dans la forme. Publié en février dernier dans un contexte de compétitivité dégradée, le Clean Industrial Deal, ou Pacte pour une industrie propre, compile les mesures européennes en cours sur toute la chaîne de la décarbonation : approvisionnement en électricité, accès aux financements, recours à la commande publique, assouplissement de la réglementation en matière d’octroi d’aides d’État, etc.
De façon plus prospective, plusieurs signaux faibles convergent vers une implication croissante de l’Europe en matière de décarbonation compétitive. À court terme d’abord, le dumping chinois a rappelé le rôle critique de la politique commerciale – compétence européenne exclusive – comme levier de protection de la compétitivité industrielle. La Commission a, par exemple, mis en place à l’automne dernier des droits compensateurs sur les importations de véhicules électriques à batterie en provenance de Chine, à la suite d’une enquête antisubventions. À moyen terme ensuite, l’augmentation des revenus découlant du SEQE offre une latitude supplémentaire en matière de financement européen, comme en témoigne le projet récemment annoncé de création d’une Banque européenne de la décarbonation dotée de 100 milliards d’euros, qui y puisera en partie. À long terme enfin, l’expérience de la difficile électrification de l’industrie automobile européenne fournit un argument, audible depuis peu à Bruxelles, au fait de coupler la politique climatique à une dose de politique industrielle. La décision récente d’assouplir le calendrier de réduction des émissions de CO2 pesant sur les constructeurs automobiles, pour leur éviter de lourdes amendes, en est un premier pas. Toutefois, penser une véritable politique industrielle à l’échelle européenne signerait, le cas échéant, une nouvelle étape dans le processus d’intégration européenne, ce qui n’en reste pas moins un défi politique et institutionnel de taille.