Exposé d’Arnaud Montebourg
Le traumatisme de l’effondrement industriel
C’est d’un traumatisme qu’est né mon combat pour la défense de l’industrie française. J’étais alors président du conseil général de Saône-et-Loire, département agricole, mais aussi très industriel, qui comptait de grands noms comme Areva, Schneider Electric, Michelin, Saint-Gobain, Safran ou Alstom, ainsi qu’une myriade de petites et moyennes entreprises (PME) qui tentaient de se faire une place dans le marché mondial. J’ai assisté à l’effondrement de ce tissu industriel entre 2009 et 2012, années sanglantes pour l’industrie française. Ce fut une “boucherie” – je n’ai pas d’autre mot – dans notre département. Nous n’avions aucun outil pour y faire face, en dehors du chômage technique, nettement insuffisant, et de la médiation du crédit. Nous en étions réduits à tenir des réunions pour constater la fermeture d’établissements et la multiplication de plans sociaux. Les préfets n’étaient pas compétents en la matière et nous ne disposions pas de fonds publics pour venir en aide aux entreprises – tout juste pouvait-on reporter le paiement de leurs cotisations sociales. Nous manquions de tout pouvoir d’action. Le chirurgien était démuni devant le malade.
Cette situation m’a traumatisé et j’ai juré d’en tirer des leçons. Durant la primaire du parti socialiste, j’avais apporté mon lot d’idées, y compris protectionnistes – par exemple, j’ai toujours été opposé à une entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sans la moindre contrepartie, sans obligation de respecter les lois environnementales minimales ni les accords du Bureau international du travail (BIT) en matière de droits sociaux. Quant à la religion du libre-échange consacrée par le système juridico-politique de l’Union européenne, elle me paraît jouer contre nos intérêts. De mon point de vue, les États sont tout à la fois libre-échangistes et protectionnistes, dans des proportions variables selon les moments et les secteurs : j’y vois une politique pragmatique et non idéologique. Voilà pour les aspects macroéconomiques. Au niveau microéconomique, nous devions tout faire pour sauver l’existant et combler nos manques en rapatriant des activités ou en créant des entreprises. Telle était ma définition du redressement productif. Elle a guidé mon action pendant deux ans et demi à la tête du ministère.

Agir, enfin !
Durant la campagne présidentielle de 2012, François Hollande m’a nommé représentant spécial à l’industrie et m’a envoyé sur tous les sites qui périclitaient. Mon expérience de président de conseil général m’ayant appris à mobiliser les pauvres moyens disponibles pour tenter d’infléchir le cours des choses, j’ai obtenu quelques résultats avec une entreprise du Limousin. Il n’en a pas fallu davantage pour que le futur président me voie comme un “paratonnerre” qui le protégerait dans ce domaine. Lui-même avait sillonné les établissements industriels en difficulté et avait multiplié les annonces optimistes, que ce soit chez Petroplus en Normandie ou à Florange, devant les hauts fourneaux qu’ArcelorMittal avait décidé de fermer. Une fois élu, il m’a nommé à la tête du ministère du Redressement productif.
L’une de mes premières initiatives fut de nommer des commissaires au Redressement productif, “mini-ministres” présents dans toutes les régions. Nous manquions en effet d’informations de terrain sur les entreprises de moins de 400 salariés, qui ne relevaient pas du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) et qui, si elles périclitaient, emporteraient avec elles des savoir-faire, des technologies et des parts de marché. Il restait à créer des outils de soutien aux entreprises.
Une boîte à outils du sauvetage
Pour avoir enquêté à leur sujet en tant que jeune parlementaire, je connaissais bien les tribunaux de commerce, ancienne “mafia” où les vautours se partageaient des proies choisies. Depuis, le milieu avait été quelque peu assaini. Je souhaitais que le gouvernement prenne position dans les reprises d’entreprises, par la voix de commissaires au Redressement productif qui s’exprimeraient à la barre de ces tribunaux : tel repreneur devait être privilégié, telle restructuration avait été acceptée par les syndicats et devait être menée à bien, etc. La chancellerie s’y est d’abord opposée, y voyant une immixtion dans les affaires, contraire à la séparation des pouvoirs. Jusqu’alors, les gouvernements s’étaient défaussés de leurs responsabilités sur les tribunaux de commerce. Or, pourquoi le gouvernement n’aurait-il pas pu intervenir dans des dossiers économiques qui affectaient des salariés ? S’il ne s’agissait pas d’entreprises publiques, il n’y avait aucun conflit d’intérêts ! J’ai finalement obtenu gain de cause et ai pu imposer ma vision interventionniste, ou en tout cas volontariste, qui nous obligeait à avoir une position sur chacune des faillites et à exercer notre pouvoir.
J’étais par ailleurs confronté à la Banque publique d’investissement (rebaptisée Bpifrance en 2013), qui estimait avoir d’autres missions que de sauver des “canards boiteux”. Dans le même temps, de grands sites tombaient – FagorBrandt, Rio Tinto, Mory Ducros… –, touchant à chaque fois 5 000 à 10 000 employés, sous-traitants compris. Il nous fallait donc une banque publique. La France ne comptait alors que quelques fonds de retournement, la plupart en difficulté. J’ai décidé d’actionner un instrument créé en 1945, le fonds de développement économique et social (FDES), et ai proposé au Parlement de le doter d’un budget de 400 millions d’euros destiné à financer des restructurations.
Un arsenal était donc en place, constitué du CIRI, des commissaires au Redressement productif, de la Banque publique d’investissement (quand elle détenait des participations dans les entreprises), du médiateur du crédit, du médiateur interentreprises et du FDES. J’avais également créé une cellule “restructuration” au sein de mon cabinet, pour épauler les commissaires au Redressement productif dans les dossiers difficiles.
Une méthodologie de la concertation
Il fallait désormais affiner la méthodologie du “chirurgien”. Pour cela, nous avons créé des “mini-CIRI” dans les préfectures, en nous appuyant sur les commissaires au Redressement productif. Je les réunissais régulièrement et leur demandais d’agir comme des administrateurs judiciaires, en ayant un plan de sauvetage en tête. Si l’administrateur effectif les suivait, c’était tant mieux, le tribunal de commerce les soutiendrait. Si l’administrateur exprimait des divergences justifiées, une solution pourrait être trouvée. Parfois, j’intervenais personnellement. Il m’est arrivé d’appeler Carlos Tavares, président du Groupe PSA, pour soutenir un petit producteur de joints de parebrise, sous-traitant de Valeo ! Nous convainquions les syndicats de dépasser la défense de l’emploi dans l’absolu : ils avaient intérêt à ce que nous sauvions leur entreprise, même si cela obligeait à supprimer des postes – idéalement, le moins possible et de façon temporaire, dans l’attente d’une reprise d’activité. Nous avons toujours trouvé des terrains d’entente, à deux exceptions près durant lesquelles nous nous sommes trouvés face à des syndicalistes animés par des motivations essentiellement politiques. Nous convainquions également les actionnaires de remplacer les dirigeants incompétents et d’assumer leurs pertes, après quoi nous proposions d’investir pour relancer l’entreprise. Les résultats ont été le plus souvent positifs. Nous avons sauvé des petites entreprises auxquelles les territoires et les Français tiennent, et auxquelles tout ministre de l’Économie doit tenir.
Ce dispositif satisfaisait les préfets, car il les déchargeait de dossiers économiques dans lesquels ils n’étaient guère compétents. La Banque de France, administration en chute libre, y trouvait un nouvel élan et s’appuyait sur la médiation du crédit locale pour mobiliser les banques. Les syndicats et les élus locaux avaient enfin un interlocuteur identifié.
Dévouée corps et âme, notre équipe est parvenue à démêler des situations inextricables. Les acteurs locaux ont gardé la mémoire de ce travail. Sur quelque 500 000 emplois menacés, nous en avons sauvé 80 %, mais nous avons aussi préservé des outils industriels, des savoir-faire, des brevets et des marchés partout sur le territoire. Je ne peux que regretter qu’aujourd’hui, le ministère de l’Économie ait abandonné toute politique de sauvetage. La crise de la Covid-19 imposera de la remettre sur pied.
Quand la tête résiste
Tandis que la presse locale nous soutenait, la presse nationale était plus caustique. C’est de la part de la classe dirigeante, défenseuse d’une idéologie libérale, que nous avons subi la plus forte résistance. Un compromis bien français accorde une grande liberté à cette classe et une forte protection sociale à la classe dirigée – le contraire de ce dont nous aurions besoin ! À l’instar de l’Allemagne, voire de l’Italie, il conviendrait d’assurer un meilleur partage de la valeur dans l’économie et dans les entreprises ; le besoin de protection sociale en serait moins criant. Les salariés doivent être davantage associés à la marche des entreprises. Il y a là un vivier de créativité à exploiter.
Notre aventure a été émaillée de grandes bagarres politiques, comme celle de Florange qui a failli faire exploser le gouvernement. Je suis allé jusqu’à menacer de démissionner pour défendre une nationalisation temporaire du site d’ArcelorMittal, sans obtenir gain de cause. Je reste pourtant persuadé que c’était la bonne solution : il était insoutenable de voir disparaître ces hauts fourneaux. Louis Gallois avait d’ailleurs préconisé de renationaliser ArcelorMittal, comme une sorte de retour à la nation de l’acier. C’était une évidence, mais le président et le Premier ministre n’étaient pas prêts à mener une telle politique.
Je ne me souciais pas des réactions de la Commission européenne. Si elle nous infligeait des amendes, nous les paierions ! J’ai enjoint les hauts fonctionnaires de s’affranchir de cette autorité : seule la France devait compter. Ils n’étaient pas là pour appliquer des lois et des règlements, mais pour sauver des entreprises. Si cela les obligeait à contourner certaines réglementations, je les couvrais. Loin du jardin juridico-politique à la française, tiré au cordeau, nous cultivions plutôt un jardin créatif à l’anglaise ! Je préférais prendre des risques juridiques et politiques plutôt qu’économiques et sociaux. Bien que je sois juriste de formation, je ne suis pas un fétichiste de la règle : en période de difficulté, il faut la réinventer ! Tel était l’esprit du ministère du Redressement productif. Une politique de cette nature devrait être transpartisane et se poursuivre durablement. Je n’ai jamais compris pourquoi Emmanuel Macron, qui m’a succédé au ministère de l’Économie, l’a abandonnée.
L’entreprise, champ de création du monde
Après la facette d’élu local et celle de ministre, passons à celle de chef d’entreprise, qui m’occupe aujourd’hui et à laquelle j’ai toujours aspiré. Je vois l’entreprise comme un champ de création du monde, au même titre que la politique. C’est un lieu où l’on peut transformer la société, de façon modeste, mais concrète. La politique est, au contraire, très immodeste et absolument pas concrète !
Pour créer une entreprise et y consacrer toute son énergie, son affectivité et son imagination, il faut aimer profondément ses produits. Mon analyse de la transition alimentaire et agricole m’a conduit à fonder trois marques équitables : une première d’amandes (Compagnie des Amandes), une deuxième de miel (Bleu Blanc Ruche), et enfin, une de crèmes glacées (La Mémère). Le moment semblait venu, pour les consommateurs, d’accepter un nouveau partage de la valeur et une meilleure rémunération des agriculteurs. Le client est prêt à payer le prix pour un produit dont il reconnaît la qualité et dont il peut identifier et rencontrer le producteur. Je ne doute pas que l’agriculture à vocation biologique, qui deviendra dominante dans les années à venir, s’inspirera de ce modèle.
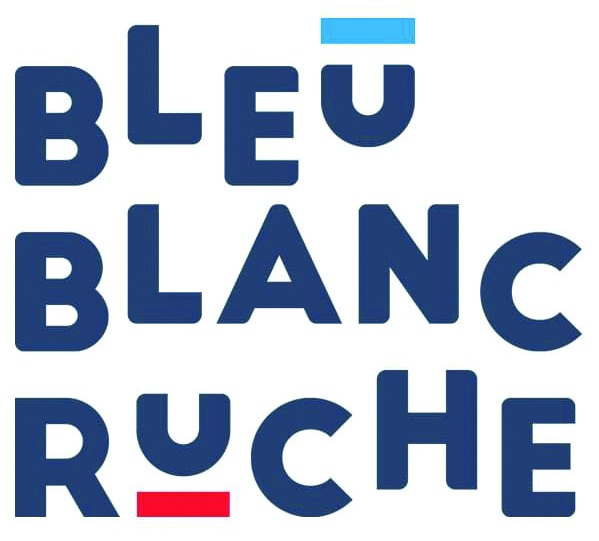


Outre du miel français de qualité, Bleu Blanc Ruche propose aux consommateurs de participer au repeuplement de la nature par les abeilles. Nous payons le miel 5 % à 18 % plus cher que le prix du marché, en contrepartie de quoi les apiculteurs s’engagent à augmenter leur nombre de ruches. Ils en ont créé 3 350 en deux ans. Au mois d’avril 2020, en plein confinement, les commandes de miel en ligne ont augmenté de 379 % !
Nous avons par ailleurs décidé de faire renaître l’amande française. Sur les 40 000 tonnes d’amandes que notre pays consomme par an, 99 % sont importées et 80 % proviennent de Californie, région qui souffre d’une pénurie d’eau et dont les sols ont été abîmés par l’agrochimie. La Provence comptait 12 000 hectares d’amandiers en 1948, mais n’en a quasiment plus. Nous levons actuellement 50 millions d’euros pour planter 2 000 hectares d’amandiers, à raison de 80 vergers de 25 hectares. Notre modèle économique n’est pas celui de l’acquisition foncière, mais de d’alliance du capital avec le travail et de l’ouverture du capital. Nous nous associons avec les producteurs sur une durée de vingt-cinq ans, en restant minoritaires dans leur capital. Ce faisant, nous respectons les propriétés agricoles familiales et la tradition de polyculture. L’agriculteur apporte son savoir-faire, tandis que nous lui apportons un financement, un soutien technique par l’entremise de l’Institut national de la recherche agronomique (qui figure au capital de la Compagnie des Amandes) et des débouchés commerciaux : nous sommes capables d’écouler 3 000 tonnes d’amandes françaises bio sur le marché. Le potentiel est majeur, sachant que l’Union européenne consomme l’équivalent de 3 milliards d’euros d’amandes par an, et que le prix de l’amande ne cesse de croître depuis vingt ans.
Avec des investisseurs japonais amoureux de la France, enfin, nous avons fondé les glaces bio La Mémère, sur un modèle bien particulier : nous dotons des éleveurs laitiers de sorbetières afin qu’ils transforment leur lait en crèmes glacées, le tout sous la direction technique de David Wesmaël, maître glacier et meilleur ouvrier de France. C’est l’alliance enfin réalisée des ouvriers et des paysans ! Cette glace est commercialisée en circuit court, la valeur étant partagée avec les agriculteurs. Le prix de vente du lait conventionnel, à hauteur de 35 centimes d’euro, ne leur permet pas de gagner leur vie. Pendant la crise du lait de 2015, il est même tombé à 30 centimes. Le lait bio se vend pour sa part entre 45 et 46 centimes, et nous l’achetons à 80 centimes, soucieux d’honorer le travail des éleveurs. La Mémère est distribuée dans les grandes enseignes nationales et réalise d’excellents résultats.
J’ai naturellement d’autres projets, encore faut-il que je parvienne à les financer, après avoir consacré toutes mes économies aux trois précédents !
Débat
Un intervenant, ancien commissaire au Redressement productif : Votre action en tant que ministre a été extrêmement appréciée par les acteurs de terrain, car enfin, ils avaient un interlocuteur, et enfin, l’État s’intéressait aux entreprises en difficulté ! Jusque-là, le ministère de l’Économie se focalisait sur les belles entreprises et les start-up, mais avait un certain dédain pour les “malades”. En 1999, alors que Michelin fermait une usine, Lionel Jospin affirmait d’ailleurs : « L’État ne peut pas tout »… Au-delà de leurs actions commando, les commissaires au Redressement productif jouaient un rôle fédérateur et orchestraient des solutions avec toutes les parties prenantes : banques, tribunaux de commerce, grands donneurs d’ordres… Ils étaient des interlocuteurs légitimes pour réunir ces acteurs et impulser un travail collectif – l’idéal étant que la dynamique se poursuive sans l’intervention du ministère.
Pour l’avoir vécue, l’arrivée d’Emmanuel Macron à la tête du ministère fut un traumatisme. Jusque-là, les réunions que vous animiez étaient galvanisantes et aboutissaient à des solutions pragmatiques et efficaces. Lors de sa première réunion, Emmanuel Macron nous a lancé : « Que puis-je faire pour vous ? » Nous avons été estomaqués. Manifestement, il ne s’intéressait pas à notre action. La campagne présidentielle qui se profilait l’attirait plutôt vers des enjeux nationaux et internationaux. Les aspects microéconomiques, pourtant fondamentaux, étaient totalement négligés. J’ose espérer que l’année 2020 sera marquée par un revirement, en réponse à la crise du coronavirus.
Ministre ou patron, qui est le mieux armé ?
Int. : L’action publique locale n’est-elle pas aussi une forme d’entrepreneuriat ? En tant que ministre, n’avez-vous pas agi comme un entrepreneur, mâtiné d’un pompier et d’un bâtisseur ?
A. M. : Plus encore que des pompiers, nous étions un commando des forces spéciales ! Nous prenions le pouvoir sur les problèmes, bien loin de la manie politique consistant à se défausser et à fuir les difficultés. Nous étions déterminés à affronter les problèmes, quitte à gravir l’Everest par la face nord en tongs ! C’était un sport de combat. Nous avons par ailleurs été des architectes – en témoignent nos 34 plans industriels.
En comparaison, la vie d’entrepreneur est créative et, finalement, peu contraignante, l’entrepreneur se consacrant à ce qu’il aime. Les contraintes ne sont évidemment pas absentes : négociations avec les banquiers, décryptage du droit des sociétés et du droit environnemental (un capharnaüm touffu, urticant et inutile…). Il est bien plus facile d’entreprendre que de se lancer dans l’action publique, car celle-ci vous confronte inévitablement à une pesanteur hiérarchique et administrative, à la vindicte de l’opinion et des réseaux sociaux et au contrôle du Parlement, qui sont autant de freins. Au contraire, un entrepreneur qui crée de l’activité et de l’emploi n’a que des soutiens ; il unit plus facilement les cœurs et les âmes.
Int. : En tant que ministre, n’est-il pas plus facile de légitimer le rôle de pompier, qui agit dans l’instant, que celui d’architecte, qui vise le long terme ?
A. M. : Il est au contraire plus facile d’agir en architecte, sans être pris par l’urgence. Les plans industriels ont d’ailleurs donné naissance à de très beaux projets. Malheureusement, mes successeurs ne les ont pas poursuivis. Notre pays n’a pas compris que la question industrielle était transpartisane et devait survivre à tous les changements politiques.
Int. : Encore faut-il en avoir le temps !
A. M. : Le temps n’est pas une contrainte pour un ministre, non seulement parce qu’il se dévoue entièrement à sa mission et à son pays, mais aussi parce qu’il peut se démultiplier à l’infini, à condition d’être secondé par les bonnes personnes. Les moyens humains et techniques d’un ministre sont illimités.
Int. : Si vous redeveniez ministre, que changeriez-vous par rapport à votre expérience précédente ?
A. M. : J’engagerais de façon plus libre et astucieuse un rapport de force avec les grands groupes mondialisés. Je n’ai pas pu le faire pleinement, car je n’étais pas soutenu. Pourtant, les outils ne manquent pas pour défendre la souveraineté économique : nationalisations, financements, fiscalité, dette environnementale, mesures discriminatoires sur les produits, commande publique...
Int. : Tandis que les grandes entreprises sont obsédées par la décision, les politiques le sont par la communication et les PME sont plutôt animées par l’action. Votre expérience éclaire-t-elle cette triple définition du management ?
A. M. : La communication ne dicte pas l’action du politique, elle la structure. Elle l’emprisonne quelque peu, mais est fondamentale. Vous aurez beau multiplier les actions, si personne ne le sait, vous ne susciterez pas de dynamique durable. Pour l’entrepreneur, c’est plutôt l’action qui structure la communication.
Écouter le terrain et réunir les expertises
Int. : Les 34 plans industriels que vous avez lancés en 2013 n’étaient-ils pas trop nombreux et divers pour avoir un réel effet ?
A. M. : Plus les plans étaient nombreux, plus nous avions de chances d’engranger des réussites ! La France avait un tel retard à rattraper que nous devions multiplier les pistes, d’autant que les ressources et les compétences étaient bien présentes, et que les plans étaient portés par les filières.
Ces plans allaient du véhicule à basse consommation à la chimie verte et aux biocarburants, en passant par le big data, la nanoéléctronique, la souveraineté des télécoms, la rénovation thermique des bâtiments, les satellites à propulsion électrique, ou encore les dirigeables pour le transport de charges lourdes. Pourquoi une telle diversité ? La France compte 73 pôles de compétitivité et ses entreprises, des plus petites aux multinationales, se répartissent dans tous les secteurs. Les plans industriels ont été proposés par les filières ; il s’agissait souvent de projets existants qui n’arrivaient pas à éclore. Le plan dédié aux dirigeables était par exemple l’occasion d’associer Airbus, une PME d’Aix-en-Provence détentrice de brevets et des partenaires internationaux. Airbus a abandonné le projet après s’être séparé de son directeur de la R&D, mais ce dernier le poursuit dans un autre cadre, avec des investisseurs étrangers.
Un autre plan concernait les équipements de diagnostic de santé, domaine dans lequel le déficit extérieur de la France atteignait 800 millions d’euros. Nous avions décidé d’y investir et de concevoir un plan avec les entreprises du secteur, qui en assureraient le pilotage. J’organisais pour cela des ententes entrepreneuriales, principe honni par l’Union européenne ! Qu’importe, je couvrais les entreprises. La Banque publique d’investissement faisait toujours partie du tour de table. Chaque plan était par ailleurs expertisé par trois personnalités extérieures, qui en jugeaient les forces et les failles. Cette méthodologie faisait naître des plans fédérateurs, issus des filières, alimentés par des ressources publiques.
Le seul plan qui ait survécu est dédié aux batteries. Il inclut le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), dont un laboratoire maîtrise toutes les briques technologiques nécessaires. Notez que nous avions refusé de choisir des orientations technologiques en amont, considérant que le marché y procéderait.
La souveraineté était un des piliers de ce programme. Notre plan industriel dédié au big data avait pour devise : Construire la France de la souveraineté numérique. Nous avions élaboré un projet très avancé avec les entreprises du secteur – Criteo, Atos, Dassault Systèmes… Un autre plan portait sur le cloud : j’avais forcé OVH et Atos à travailler ensemble pour construire notre autonomie au plan européen. Rien ne s’est plus passé après mon départ, car ils n’arrivaient pas à collaborer : il leur manquait l’impulsion d’un ministre. Un plan était également consacré à la souveraineté des télécoms – Huawei faisait déjà sentir sa puissance –, mais nous n’avons pas pu légiférer en la matière, le Premier ministre voulant préserver les relations franco-chinoises. En six ans, nous aurions pu beaucoup faire dans tous ces secteurs !
Int. : Les filières sont-elles l’échelon le plus pertinent pour proposer et porter des projets industriels ? Leurs membres n’ont-ils pas des intérêts trop divergents pour s’entendre ?
A. M. : Une filière doit savoir gérer ses divergences internes, ses membres étant en concurrence mutuelle. Elle doit être aiguillonnée par une impulsion politique et stratégique, doublée de commandes publiques ou de financements d’État. Malheureusement, la France n’emploie pas la commande publique dans un but patriotique, à la différence de l’Allemagne, de l’Italie, des États-Unis, de la Chine ou encore du Japon.
La commande publique est un outil par excellence pour agir dans des secteurs comme la défense nationale, la santé, l’alimentation, le numérique ou la nanoélectronique. Au-delà des financements qu’il attribue, l’État est capable de nouer des alliances à l’international lorsque les acteurs français sont de trop petite taille. Les filières ont des idées en la matière, car elles connaissent les entreprises, leurs forces et leurs faiblesses ; elles peuvent facilement organiser des partenariats. Elles ont des revendications corporatistes que l’État doit satisfaire en imposant des contreparties, qu’elles sont promptes à accepter. Tout le monde est volontaire, mais pour cela, il faut un vrai ministre !
Int. : Peut-on envisager un renouveau industriel sans intervention de l’État ?
A. M. : C’est impossible, tant l’État est structurant en France. Nous devons non seulement réhabiliter le ministère de l’Industrie, mais aussi trouver des dirigeants plus compétents.
Int. : Identifiez-vous, en France, des personnalités capables de donner un nouvel élan à l’industrie ?
A. M. : Il y en a partout !
Int. : Comment améliorer la formation des dirigeants industriels ?
A. M. : Nous avons de bons dirigeants industriels, mais pas assez d’ingénieurs ni d’entrepreneurs. Les jeunes diplômés d’écoles de commerce se précipitent vers la banque et le marketing, tandis que les jeunes ingénieurs manquent de compétences managériales. Il faudrait créer quelques écoles d’entrepreneuriat, avec des promotions abondantes, pour former au management des PME. Là est l’avenir de notre pays.
Qui pour conseiller l’État ?
Int. : Vous avez été l’un des rares ministres à mobiliser le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET). Qui est à même de jouer un rôle de conseil auprès de l’État ?
A. M. : J’ai abondamment recouru au CGEIET pour mener des expertises sur les grandes entreprises au sujet desquelles j’avais à me prononcer. Le ministère avait besoin d’autres compétences que celles d’énarques qui ne connaissaient les entreprises que dans la théorie ! L’économie est une science imparfaite et difficile, qui a besoin de s’appuyer sur des scientifiques indépendants et venant du monde entier. Dans les laboratoires de recherche pourtant, les trois quarts des économistes sont payés par des banques – de même que l’immense majorité des hauts fonctionnaires du Trésor terminent leur carrière dans la banque et l’assurance. Nos vrais conseillers étaient donc les filières, les entreprises et les universitaires. J’estime d’ailleurs que le directeur du Trésor devrait être un chercheur. Quant au Conseil d’analyse économique, proche du Premier ministre, il est prospectif et ne s’inscrit pas dans l’action politique.
Int. : Le poids de l’Administration et des cabinets ne l’emporte-t-il pas parfois sur celui des ministres ?
A. M. : On ne peut pas espérer corriger un mauvais ministre par le biais de son administration. Si le ministre est mauvais, l’administration l’est aussi ! Les cabinets ont pour mission de contrôler cette dernière. Je suis favorable à leur renaissance, car ils sont capables de porter un nouveau regard sur la machine administrative. Dans mes cabinets, je mêlais d’ailleurs des militants, des intellectuels, des scientifiques, des ingénieurs, des entrepreneurs et des hauts fonctionnaires. Aujourd’hui, les administrations vendent leur politique – toujours la même – à des ministres sans consistance ni expérience. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres de l’Administration, mélanger les profils, organiser des mobilités. L’action politique doit s’appuyer sur un cabinet diversifié.
Int. : Bpifrance vous semble-t-elle jouer un rôle pertinent aux côtés du ministère de l’Économie ? Est-elle une alternative nécessaire au système bancaire traditionnel ?
A. M. : En intervenant en surgarantie, Bpifrance a déresponsabilisé le secteur bancaire privé. Dès qu’une entreprise sollicite un prêt, la banque consulte Bpifrance, qui en assure la garantie à 50 % ou 60 %. Bpifrance accorde elle-même très peu de crédits, à hauteur de 5 % du marché. En période d’assouplissement quantitatif, Bpifrance aurait dû davantage financer ce qui ne pouvait pas l’être par les banques privées.
Bpifrance a créé des fonds, mais me semble trop timorée en la matière. Si elle veut être audacieuse à la place des banques, elle doit prendre des risques et les expliquer aux contribuables. Cela impliquerait d’isoler cette activité, pour qu’elle ne mette pas en péril l’établissement dans son ensemble. À l’occasion du grand emprunt, nous avions abondé, à hauteur de 1 milliard d’euros, un fonds consacré à la réindustrialisation. En huit ans, il n’a financé que six ou sept projets ! J’y vois l’effet de la peur.
De façon générale, je suis opposé aux prêts garantis par l’État, car ils accroissent la dette des petites entreprises et risquent d’entraîner leur chute si elles peinent à rembourser. Moi-même, je n’y recours d’ailleurs pas pour mes marques. En revanche, il serait utile d’accorder des subventions aux très petites entreprises, qui réalisent moins de 1 million d’euros de chiffre d’affaires, afin de compenser, quand il y a lieu, leurs pertes de revenus. S’agissant des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les prêts garantis par l’État mériteraient d’être transformés en obligations convertibles. En cas de non-remboursement, l’État prendrait une participation au capital. Les entreprises y trouveraient des fonds propres plutôt que des dettes et l’État y trouverait des actifs plutôt que de la dette, puisque les créances de long terme qu’il aurait sur ces entreprises auraient de la valeur.
Enfin, il n’y a pas lieu pour l’État de prendre des participations dans des grands groupes. Pourquoi renflouer Air France, alors que ses actionnaires n’y injectent pas un centime ? Ce n’est pas acceptable. De ce point de vue, la politique de sauvetage me semble très mal menée.
Oser la souveraineté
Int. : Face à la crise actuelle, la reconstruction industrielle ne doit-elle pas s’organiser à l’échelle européenne, afin de s’appuyer sur une vraie souveraineté et sur un marché d’une taille critique ?
A. M. : La France a fait suffisamment de sacrifices pour Bruxelles. En bon élève de la classe européenne, elle est la victime des politiques communautaires. La France doit être notre priorité. Pour l’Europe, nous verrons plus tard ! Je suis favorable à une plus grande subsidiarité dans la fabrication de la norme européenne, car cela éviterait à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne d’exercer un pouvoir excessif et abusif. La transposition des directives ne serait plus de mise, et chaque parlement serait autorisé à défendre ses spécificités. Il ne serait en rien dramatique que tous les États membres n’aient pas strictement le même droit !
L’Europe a été incapable d’impulser une transition écologique, les mix énergétiques polonais et allemands en témoignent. La taxe carbone européenne ne verra pas le jour tant qu’elle exigera l’unanimité des États membres. Voilà un premier échec. Le deuxième échec constaté est que, face à la crise de 2008 et 2009, l’Europe n’a fait que prolonger inutilement la souffrance des peuples européens par des politiques d’une austérité sans nom. Cela nous a coûté dix ans de déflation ! Troisième échec, l’Europe n’a pas traité la question migratoire. Aujourd’hui, en plein cœur de la crise de la Covid-19, l’Europe se montre absente et défaillante, voire nuisible. Concentrons-nous sur la France, qui a besoin de se reconstruire ! Si cela se fait avec l’Europe, tant mieux, car nous avons besoin de peser face aux empires américain et chinois ; mais nous pouvons aussi nous en passer. La Corée, avec ses 51 millions d’habitants, prouve qu’un petit pays peut tirer son épingle du jeu international. Jusqu’à présent, l’Union européenne n’a pas suffisamment servi les intérêts de la France.
Int. : Votre décision d’étendre le contrôle des investissements étrangers à des secteurs stratégiques comme les transports, l’aviation et l’énergie, au-delà de la seule industrie de défense, a eu un effet décisif pour se prémunir de comportements agressifs ou prédateurs de groupes internationaux. C’est un atout à l’heure où la crise de la Covid-19 oblige à repenser notre souveraineté économique dans des secteurs liés notamment à la santé. Cette initiative a-t-elle été facilement acceptée ? Comment pouvons-nous en tirer profit ?
A. M. : Il n’a pas été facile d’imposer cette mesure. On me rétorquait que l’Union européenne s’y opposerait – ce qui, vous l’aurez compris, ne me chagrine guère ! Depuis, l’Europe a d’ailleurs adopté cette disposition. Malheureusement, mes successeurs ne l’ont pas appliquée.
Le plan Made in China à l’horizon 2025, édicté par le gouvernement chinois en 2015, identifie 10 secteurs-clés dans lesquels doivent être créés 40 centres d’innovation – l’équivalent de nos pôles de compétitivité. Ils recouvrent les nouvelles énergies, la robotique, l’aéronautique, l’ingénierie océanique, le ferroviaire, les télécoms, les nouveaux matériaux, les machines agricoles, la biomédecine, etc. Le fait est que 15 de ces centres ont déjà vu le jour.
Qu’a fait la France de ces secteurs ? Dans les télécoms, elle a vendu Alcatel ; dans le ferroviaire, elle a failli vendre à Siemens le peu qui lui restait ; dans l’ingénierie océanique, elle a vendu Technip ; dans l’aéronautique, elle a laissé partir Latécoère ; dans la robotique, elle est importatrice ; dans les nouvelles énergies, Alstom a été vendu à General Electric ; le machinisme agricole a disparu ; la biomédecine résiste, mais grâce à une industrie pharmaceutique très internationale ; enfin, les projets touchant aux nouveaux matériaux dorment dans les cartons du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et du CEA. Ne nous étonnons pas de devenir les esclaves des empires américain et chinois ! Un pays qui ne s’intéresse pas à ces secteurs n’a aucune chance de survivre dans le monde actuel.
Int. : Qu’en est-il de votre action en faveur du “made in France” ?
A. M. : Je mène une bataille culturelle, considérant qu’il n’y a rien de choquant à défendre et à aimer son pays. En tant qu’entrepreneur, je mise non pas sur des discours, mais sur des actions concrètes, à commencer par la mention obligatoire de l’origine des produits. La Commission européenne y voit un obstacle au commerce… Un miel de France n’a donc pas le droit de dire qu’il est français ! Notre gouvernement n’a pas été capable d’imposer cette mesure, tandis que l’Espagne y est parvenue. Je mène ce combat dans ma filière, avec ses acteurs.
Le compte rendu de cette séance a été rédigé par :
Sophie JACOLIN

